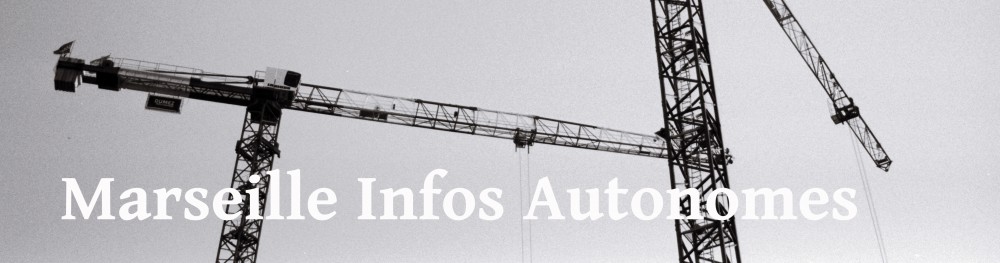On ne peut comprendre la situation actuelle en Irak sans revenir sur ses origines. De 1980 à 1988, un million de victimes tombaient dans la guerre opposant l’Irak et l’Iran. Ce carnage n’aurait pas été possible si Saddam Hussein et son régime n’avaient bénéficié du soutien massif des monarchies arabes du Golfe et des grandes puissances occidentales, dont nous savons maintenant qu’elles armaient également, plus discrètement, l’Iran. Ces puissances présentaient alors l’Irak comme le camp de « la laïcité et de la modernité », face à la « barbarie religieuse » du régime iranien. Mais pour les besoins de cette guerre, les deux régimes réactivaient en fait des antagonismes religieux anciens, opposant chiites et sunnites, que le développement de la société, notamment irakienne, avait résorbé. Les deux régimes faisaient ég alement mine de soutenir les minorités linguistiques ou nationales opprimées par leur voisin, tout en continuant à opprimer celles qui étaient sur leur sol .
On ne peut comprendre la situation actuelle en Irak sans revenir sur ses origines. De 1980 à 1988, un million de victimes tombaient dans la guerre opposant l’Irak et l’Iran. Ce carnage n’aurait pas été possible si Saddam Hussein et son régime n’avaient bénéficié du soutien massif des monarchies arabes du Golfe et des grandes puissances occidentales, dont nous savons maintenant qu’elles armaient également, plus discrètement, l’Iran. Ces puissances présentaient alors l’Irak comme le camp de « la laïcité et de la modernité », face à la « barbarie religieuse » du régime iranien. Mais pour les besoins de cette guerre, les deux régimes réactivaient en fait des antagonismes religieux anciens, opposant chiites et sunnites, que le développement de la société, notamment irakienne, avait résorbé. Les deux régimes faisaient ég alement mine de soutenir les minorités linguistiques ou nationales opprimées par leur voisin, tout en continuant à opprimer celles qui étaient sur leur sol .Sous l’égide de l’ONU, ces puissances occidentales confièrent suite à cette guerre aux partis nationalistes de la bourgeoisie kurde la gestion d’une zone autonome au Kurdistan d’Irak, pour se les attacher et se créer dans cette région une zone d’influence. Ce n’étaient évidemment pas les Kurdes et leur sécurité qui importaient pour ces puissances, qui désignaient alors comme terroristes les Kurdes qui, dans la Turquie voisine, étaient à ce moment-là sous le feu de l’armée d’un État qui les opprime.
Dans le reste de l’Irak, la population était plongée dans la misère et la malnutrition par un embargo meurtrier. Alors que le régime irakien s’affaiblissait, la Maison-Blanche maintenait des contacts réguliers avec les organisations les plus réactionnaires de l’opposition irakienne. Suite à l’invasion américaine de 2003, ce sont ces organisations qui réorganisèrent le pays, sur les bases confessionnelles et ethniques actuelles.
Le pays a plongé depuis dans une guerre civile et confessionnelle où la population, les femmes, les travailleurs-ses et leurs droits sont sacrifiés, tandis que se sont ouverts sur leurs dépouilles de nouveaux marchés pour les capitalistes et les investisseurs étrangers.
C’est sur ce terreau de la misère, des désordres, des discriminations et affrontements de pouvoir sous prétexte de religion que la politique des gouvernements fantoches irakiens successifs ont suscités ou aggravés que l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) a pu s’implanter en Irak, et amplifier les exactions et les persécutions qui y avaient déjà cours.
Cette milice, l’EIIL, dispose, à en croire les études disponibles, d’une trésorerie de plus de deux milliards de dollars. Ce fonds de roulement doit beaucoup, selon certain-e-s, à l’Arabie Saoudite qui aurait soutenu cette organisation au moins jusqu’en 2013, sous prétexte de s’opposer au régime syrien. Y contribuent quoi qu’il en soit de riches donateurs résidant dans les pétromonarchies, et notamment au Koweït.
Ce sont ces moyens financiers, les armes qu’ils permettent de se procurer et les mercenaires étrangers qu’ils permettent d’attirer, qui ont permis à ces milices de s’imposer dans une partie des » régions sunnites » marginalisées et paupérisées par le gouvernement irakien et de fixer, pour partie, au mécontentement qui les traverse des objectifs fascistes.
Sous les coups de ces milices, les femmes sont soumises à une dictature patriarcale brutale ; les minorités assyriennes, chrétiennes, les Yézidis, les opposants au fondamentalisme religieux ont bien souvent fui leurs maisons, villes et villages.
Mais, dans sa guerre contre l’EIIL, ce sont les quartiers résidentiels et les hôpitaux des régions désignées comme sunnites qui sont visés en représailles par les bombardements ordonnés par le gouvernement à dominante chiite de Nouri al-Maliki. Ce dernier, qui n’hésite pas à des barils explosifscomme le signale Human Right Watch, vaut-il vraiment mieux que ses adversaires ?
Au Kurdistan d’Irak, Amnesty International a également noté que le gouvernement régional kurde de Massoud Barzani faisait entrave aux personnes en fuite qui souhaitent se réfugier dans les villes protégés du conflit armé.
Ces persécutions, cette oppression, les États occidentaux qui en ont ouvert la voie de longue main semblent les découvrir soudainement aujourd’hui. S’en servant comme prétextes, ils travaillent du même coup, sous couvert humanitaire, à justifier leur intervention armée et leur présence dans la région, en faisant oublier au passage leur complicité dans bien d’autres massacres en cours.
Quelle solidarité ?